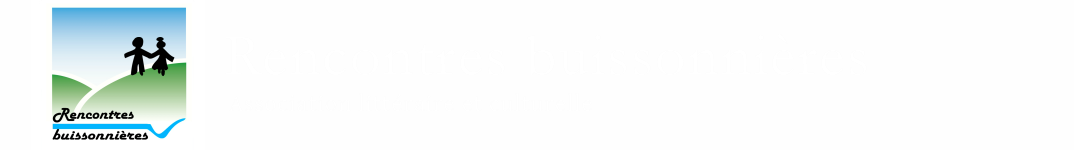C’était en 1951. Jacques Chauviré, médecin généraliste à Neuville-sur-Saône, formé à une science qui, en ce temps-là, était encore une humanité, et même une philosophie, avait des amis dont l’enfant était atteint d’une scoliose. Il préconisa, avec raison, des exercices de natation en piscine. Peu de temps après, dans une crique où ses parents l’avaient conduit, le garçonnet se noya par hydrocution. Un demi-siècle plus tard, d’une voix d’ombre qui tremble dans le soir d’hiver, le vieil homme se souvient : « J’ai eu le sentiment d’être trahi. J’ai pensé qu’une telle épreuve m’interdisait désormais tout bonheur. En proie au cafard, à l’échec, à l’idée que j’étais voué, dans mon métier, à illustrer le mythe de Sisyphe, j’ai envoyé une lettre à Albert Camus. Je pensais en effet que lui seul pouvait comprendre. »
C’était en 1951. Jacques Chauviré, médecin généraliste à Neuville-sur-Saône, formé à une science qui, en ce temps-là, était encore une humanité, et même une philosophie, avait des amis dont l’enfant était atteint d’une scoliose. Il préconisa, avec raison, des exercices de natation en piscine. Peu de temps après, dans une crique où ses parents l’avaient conduit, le garçonnet se noya par hydrocution. Un demi-siècle plus tard, d’une voix d’ombre qui tremble dans le soir d’hiver, le vieil homme se souvient : « J’ai eu le sentiment d’être trahi. J’ai pensé qu’une telle épreuve m’interdisait désormais tout bonheur. En proie au cafard, à l’échec, à l’idée que j’étais voué, dans mon métier, à illustrer le mythe de Sisyphe, j’ai envoyé une lettre à Albert Camus. Je pensais en effet que lui seul pouvait comprendre. »
 L’auteur de La Peste, qui regrettait pour sa part de n’avoir pas été médecin, lui répondit aussitôt et lui conseilla d’écrire. Les deux hommes révoltés devinrent des amis, ils échangèrent une belle correspondance où il est question du bien et du mal, de la foi et du néant, de la souffrance humaine et du difficile métier d’exister. Jacques Chauviré commença alors à tenir son Journal d’un médecin de campagne, qu’il ne consentit à publier qu’au soir de sa vie. Entre l’observation clinique de la souffrance, le relevé méthodique de la misère, le spectacle inadmissible de la mort et, a contrario, l’immémoriale beauté des paysages traversés, il n’est jamais en paix (…) Catholique et croyant, il se demande où loge l’âme dans les corps brisés, quelles sont les frontières exactes de la condition humaine, et si « le Christ a souffert d’angoisse. » (…) Le soir, après avoir fait le tour des fermes isolées, des lits défaits et des douleurs inexprimées, l’inconsolable docteur lit Vie de Jésus de Mauriac, Les Cantiques spirituels de Saint Jean de la Croix, les conférences de Lacordaire, de Claudel et de Simone Weil. Il prie comme on appelle au secours (…)
L’auteur de La Peste, qui regrettait pour sa part de n’avoir pas été médecin, lui répondit aussitôt et lui conseilla d’écrire. Les deux hommes révoltés devinrent des amis, ils échangèrent une belle correspondance où il est question du bien et du mal, de la foi et du néant, de la souffrance humaine et du difficile métier d’exister. Jacques Chauviré commença alors à tenir son Journal d’un médecin de campagne, qu’il ne consentit à publier qu’au soir de sa vie. Entre l’observation clinique de la souffrance, le relevé méthodique de la misère, le spectacle inadmissible de la mort et, a contrario, l’immémoriale beauté des paysages traversés, il n’est jamais en paix (…) Catholique et croyant, il se demande où loge l’âme dans les corps brisés, quelles sont les frontières exactes de la condition humaine, et si « le Christ a souffert d’angoisse. » (…) Le soir, après avoir fait le tour des fermes isolées, des lits défaits et des douleurs inexprimées, l’inconsolable docteur lit Vie de Jésus de Mauriac, Les Cantiques spirituels de Saint Jean de la Croix, les conférences de Lacordaire, de Claudel et de Simone Weil. Il prie comme on appelle au secours (…)
Le 4 octobre 1954, Albert Camus confiait dans une lettre à Jacques Chauviré: « Nous sommes tous à la recherche d’un fleuve nourricier, d’une source ancienne et première. Nous devons vivre pour et à cause de ces instants. Les partager, voilà notre seule générosité possible, la seule vertu que je connaisse. »
Neuville-sur-Saône, 2 avril 2005.
Ce fut, ce samedi-là, ma dernière visite à Jacques Chauviré. J’étais venu m’entretenir avec lui pour France Culture. Il avait encore maigri, respirait mal, pleurait discrètement des larmes d’épuisement. Les rideaux avaient été tirés pour empêcher la lumière éclatante de pénétrer dans son petit appartement. Trois heures durant, il me fit le cadeau d’une ultime et testamentaire conversation. D’avoir soigné les malades pendant quarante ans à Neuville-sur-Saône ne l’avait jamais accoutumé à la souffrance ; la sienne seule semblait négligeable à cette âme chrétienne.
De même préférait-il parler du théâtre de Racine, des Mémoires de Saint-Simon et des poèmes de Rimbaud que de ses propres romans. Lorsque le soir tomba, je lui dis au revoir, il me prit les mains et les serra très fort, en signe de jamais plus. Le lundi matin, 4 avril, l’un de ses fils retrouva Jacques Chauviré couché dans l’entrée. Il avait enfin retrouvé le vert paradis de ses amours enfantines et sa chère Elisa…
« Lorsque mon frère aîné et moi-même l’avons lavé et vêtu pour la dernière fois, il était tiède encore, j’ai noué sous son col la cravate qu’il avait choisie dès cinq heures du matin pour vous recevoir », m’écrivit sa fille.
Il est enterré, parmi les siens, au cimetière de Genay.
 Contrairement aux écrivains ou aux peintres, Barbara partageait, avec les très grands comédiens et quelques illustres écuyers, l’ambition de laisser une trace immatérielle dans le cœur et la mémoire des spectateurs d’un soir, cette bouleversante cohorte de privilégiés inconsolés qui s’amenuise avec le temps. La plus précieuse mémoire est celle qui est condamnée à l’oubli. Que restera-t-il de Nuno Oliveira, maître portugais de l’art équestre, quand disparaîtra son plus fidèle et dernier disciple, Michel Henriquet ? Et que restera-t-il de Gérard Philipe, du Prince de Hombourg, du Cid, quand se seront éteints les derniers pèlerins de la cour d’honneur du palais des papes, où Jean Vilar, autre religieux du spectacle, avait interdit aux caméras de pénétrer, car on ne met pas un miracle en boîte ? Rien d’autre qu’une rumeur, un souffle improbable, une poussière d’or. Mais les films, mais Fanfan la tulipe, mais Les Grandes Manœuvres ? Allons donc, ils sont aux comédiens de théâtre ce que les disques sont à Barbara : l’image et le son déformés de ce qui s’est passé d’unique sur la scène, le lointain écho d’une fête nocturne improvisée, qui ne se reproduira plus jamais.
Contrairement aux écrivains ou aux peintres, Barbara partageait, avec les très grands comédiens et quelques illustres écuyers, l’ambition de laisser une trace immatérielle dans le cœur et la mémoire des spectateurs d’un soir, cette bouleversante cohorte de privilégiés inconsolés qui s’amenuise avec le temps. La plus précieuse mémoire est celle qui est condamnée à l’oubli. Que restera-t-il de Nuno Oliveira, maître portugais de l’art équestre, quand disparaîtra son plus fidèle et dernier disciple, Michel Henriquet ? Et que restera-t-il de Gérard Philipe, du Prince de Hombourg, du Cid, quand se seront éteints les derniers pèlerins de la cour d’honneur du palais des papes, où Jean Vilar, autre religieux du spectacle, avait interdit aux caméras de pénétrer, car on ne met pas un miracle en boîte ? Rien d’autre qu’une rumeur, un souffle improbable, une poussière d’or. Mais les films, mais Fanfan la tulipe, mais Les Grandes Manœuvres ? Allons donc, ils sont aux comédiens de théâtre ce que les disques sont à Barbara : l’image et le son déformés de ce qui s’est passé d’unique sur la scène, le lointain écho d’une fête nocturne improvisée, qui ne se reproduira plus jamais.  On peut conserver pieusement le costume de Lorenzaccio ou celui de Lili Passion, ils ne témoignent que du regret que nous éprouvons et d’une histoire révolue à laquelle nous nous accrochons comme à un cintre dérisoire. Les morts sont si tristes, dans leurs vieux habits.
On peut conserver pieusement le costume de Lorenzaccio ou celui de Lili Passion, ils ne témoignent que du regret que nous éprouvons et d’une histoire révolue à laquelle nous nous accrochons comme à un cintre dérisoire. Les morts sont si tristes, dans leurs vieux habits.