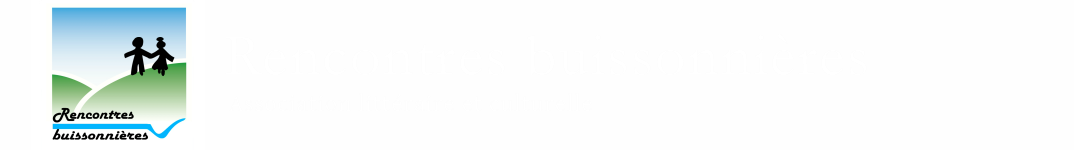Contrairement aux écrivains ou aux peintres, Barbara partageait, avec les très grands comédiens et quelques illustres écuyers, l’ambition de laisser une trace immatérielle dans le cœur et la mémoire des spectateurs d’un soir, cette bouleversante cohorte de privilégiés inconsolés qui s’amenuise avec le temps. La plus précieuse mémoire est celle qui est condamnée à l’oubli. Que restera-t-il de Nuno Oliveira, maître portugais de l’art équestre, quand disparaîtra son plus fidèle et dernier disciple, Michel Henriquet ? Et que restera-t-il de Gérard Philipe, du Prince de Hombourg, du Cid, quand se seront éteints les derniers pèlerins de la cour d’honneur du palais des papes, où Jean Vilar, autre religieux du spectacle, avait interdit aux caméras de pénétrer, car on ne met pas un miracle en boîte ? Rien d’autre qu’une rumeur, un souffle improbable, une poussière d’or. Mais les films, mais Fanfan la tulipe, mais Les Grandes Manœuvres ? Allons donc, ils sont aux comédiens de théâtre ce que les disques sont à Barbara : l’image et le son déformés de ce qui s’est passé d’unique sur la scène, le lointain écho d’une fête nocturne improvisée, qui ne se reproduira plus jamais.
Contrairement aux écrivains ou aux peintres, Barbara partageait, avec les très grands comédiens et quelques illustres écuyers, l’ambition de laisser une trace immatérielle dans le cœur et la mémoire des spectateurs d’un soir, cette bouleversante cohorte de privilégiés inconsolés qui s’amenuise avec le temps. La plus précieuse mémoire est celle qui est condamnée à l’oubli. Que restera-t-il de Nuno Oliveira, maître portugais de l’art équestre, quand disparaîtra son plus fidèle et dernier disciple, Michel Henriquet ? Et que restera-t-il de Gérard Philipe, du Prince de Hombourg, du Cid, quand se seront éteints les derniers pèlerins de la cour d’honneur du palais des papes, où Jean Vilar, autre religieux du spectacle, avait interdit aux caméras de pénétrer, car on ne met pas un miracle en boîte ? Rien d’autre qu’une rumeur, un souffle improbable, une poussière d’or. Mais les films, mais Fanfan la tulipe, mais Les Grandes Manœuvres ? Allons donc, ils sont aux comédiens de théâtre ce que les disques sont à Barbara : l’image et le son déformés de ce qui s’est passé d’unique sur la scène, le lointain écho d’une fête nocturne improvisée, qui ne se reproduira plus jamais.  On peut conserver pieusement le costume de Lorenzaccio ou celui de Lili Passion, ils ne témoignent que du regret que nous éprouvons et d’une histoire révolue à laquelle nous nous accrochons comme à un cintre dérisoire. Les morts sont si tristes, dans leurs vieux habits.
On peut conserver pieusement le costume de Lorenzaccio ou celui de Lili Passion, ils ne témoignent que du regret que nous éprouvons et d’une histoire révolue à laquelle nous nous accrochons comme à un cintre dérisoire. Les morts sont si tristes, dans leurs vieux habits.
Il faut savoir oublier les objets de Barbara, qui se sont évanouis avec elle. C’est avec ses chansons qu’elle vit en nous.