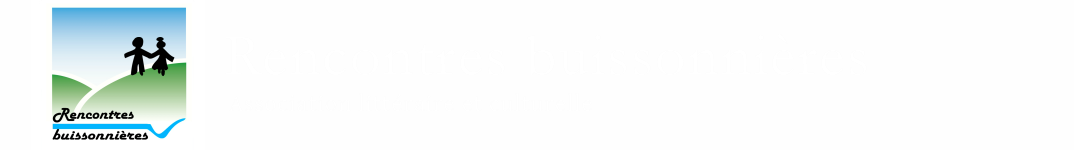La chute de cheval
Mon père est mort d’une chute de cheval le samedi 21 avril 1973, veille de Pâques, dans l’insoucieuse et très civilisée forêt de Rambouillet. Il avait quarante-cinq ans, j’allais en avoir dix-sept. Nous ne vieillirons pas ensemble.
Olivier
Que reste-t-il de toi, qui ne t’es jamais posé, qui n’a pas su ce que croître veut dire, qui n’as pas eu le privilège de te retourner sur le chemin parcouru, qui n’as pas connu le poids infini des regrets et des remords, qui as si peu existé, à peine six années, un petit et fugitif nuage de poussière blanche, un vol de papillon égaré, un éclair de chaleur au-dessus des arbres centenaires ? Des photos en noir et blanc où tu ris à l’objectif qui tente de fixer ta merveilleuse évanescence ; des films en super-8 où tu cours trop vite, sans souci du danger, et que je ne regarde pas en boucle sans frémir ; une longue ride, qui ressemble à un ruisseau d’après l’orage, sur le beau et italien visage de notre mère ; une pierre blanche dans un cimetière de Seine-et-Marne, au bout de la longue route où un chauffard t’a renversé et projeté si haut en l’air qu’on eût dit que tu ne retomberais jamais ; l’image déchirée, déchirante, de ce drame qui n’en finit pas de me hanter ; ce tout petit tombeau de papier, encore plus léger que toi, que sans doute je ne relirai jamais, que j’ai sans doute écrit afin que ton prénom soit un jour imprimé, en capitales rouges, sur une couverture blanche ; et un vide en moi, où tout résonne, dont je ne parviens pas à mesurer ni la profondeur ni la largeur, mais qui semble grandir avec le temps, inéluctablement.
Après moi, de toi, il n’y aura plus rien. Vouloir te prolonger aura été une illusion.
********
Je crois à la secrète communion de tous ceux qui ont perdu un être chéri, plus particulièrement un enfant, et que relie une abondante littérature de l’infortune. Elle repose sur une illusion capitale : chaque expérience du deuil est unique, irréductible, en apparence incomparable, et pourtant, dès qu’elle est couchée sur le papier, elle devient universelle, chacun de nous peut s’y reconnaître. On y lit ce qu’on a le sentiment d’avoir soi-même écrit.
Il fut un temps où, dans mes chroniques, je me moquais volontiers des essais d’un jeune professeur de littérature d’origine britannique qui enseignait en France et se piquait de modernité(…) Et puis un jour de 1997, je reçus de lui un livre intitulé L’Enfant éternel. Il y relatait l’agonie de sa fille, Pauline, terrassée à quatre ans par un cancer.
Au retour de ses dernières vacances à la montagne, alors qu’il neigeait sur Paris, la petite s’était plainte d’une douleur intense au bras gauche, entre l’épaule et le coude. Une biopsie avait révélé la présence d’une tumeur. Le martyre de l’enfant allait durer seize mois. Philippe Forest était âgé de trente-quatre ans. Rien ne l’avait préparé à ce calvaire.