 D’entrée, les mots de Didier Mény, doux et dignes, justes et forts, m’empoignent le cœur et ne le lâchent plus qu’à la dernière phrase. Je suis en apnée, immergée dans le souffle triste de Didier, dans le chagrin et la colère de Didier d’avoir perdu son fils unique, Tristan. Ses propos ravivent ma plus grande terreur, celle de perdre aussi un de mes enfants ou de mes petits-enfants…Le silence absolu du public me fait ressentir que nous sommes tous en totale empathie avec le parcours tragique de Didier Mény et de son épouse, et que nous admirons leur choix de continuer d’aller vers la vie, par l’adoption de deux enfants.
D’entrée, les mots de Didier Mény, doux et dignes, justes et forts, m’empoignent le cœur et ne le lâchent plus qu’à la dernière phrase. Je suis en apnée, immergée dans le souffle triste de Didier, dans le chagrin et la colère de Didier d’avoir perdu son fils unique, Tristan. Ses propos ravivent ma plus grande terreur, celle de perdre aussi un de mes enfants ou de mes petits-enfants…Le silence absolu du public me fait ressentir que nous sommes tous en totale empathie avec le parcours tragique de Didier Mény et de son épouse, et que nous admirons leur choix de continuer d’aller vers la vie, par l’adoption de deux enfants.
Par son témoignage spontané, intime et troublant, je suis aussi particulièrement émue de découvrir Jérôme Garcin en éternel « petit garçon double » et orphelin de père, dans un grand corps d’homme. Je ressens profondément que ses blessures, même comprises, évoquées ou écrites, sont toujours bien vives. Son entêtement à vivre et travailler pour deux, voire pour trois, fait écho avec ce que je partage avec « mes absents »… L’échange entre Jérôme Garcin et le fils de Jacques Chauviré est bouleversant !
Enfin, la belle voix claire de Nadine, et celle douce et enveloppante d’Etienne, tissent un cocon de tendresse autour de nous, comme pour nous consoler de ce trop-plein d’émotions…Je ressens tout au long de cette journée un rare sentiment de communion entre toutes les personnes présentes, qui se comprennent sans parler, et partagent le même sentiment d’ahurissement face à la disparition d’êtres chers…
Dominique
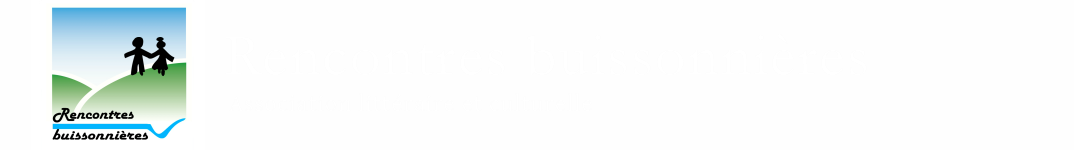
 Une journée à Cîteaux, une vie, des vies…
Une journée à Cîteaux, une vie, des vies… « D’un enfant, un amour
« D’un enfant, un amour J’ai beaucoup apprécié cette journée qui mêlait si bien le sacré, le profane, l’humain, le divin, notre belle terre et le Ciel, nos invisibles et nous, bien vivants. Des moments très émouvants, qui m’ont beaucoup touchée, mais aussi beaucoup de retenue et de pudeur. Les deux interventions de la matinée, différentes dans la forme, ont apporté de riches et profonds témoignages. Quant aux diverses lectures, elles m’ont permis d’intérioriser et de redécouvrir avec plaisir Péguy. Enfin quelle belle idée d’y insérer la musique, reflet de nos âmes ! Le guitariste était formidable, la voix parfaitement adaptée aux mélodies espagnoles….nostalgiques à souhait.
J’ai beaucoup apprécié cette journée qui mêlait si bien le sacré, le profane, l’humain, le divin, notre belle terre et le Ciel, nos invisibles et nous, bien vivants. Des moments très émouvants, qui m’ont beaucoup touchée, mais aussi beaucoup de retenue et de pudeur. Les deux interventions de la matinée, différentes dans la forme, ont apporté de riches et profonds témoignages. Quant aux diverses lectures, elles m’ont permis d’intérioriser et de redécouvrir avec plaisir Péguy. Enfin quelle belle idée d’y insérer la musique, reflet de nos âmes ! Le guitariste était formidable, la voix parfaitement adaptée aux mélodies espagnoles….nostalgiques à souhait.