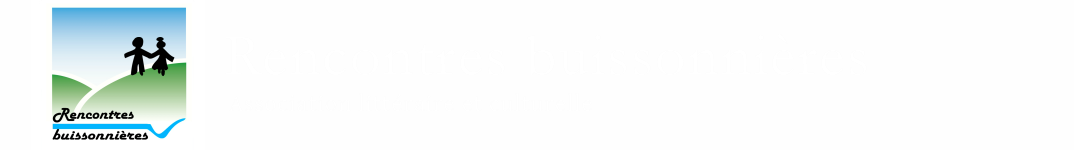Approche de la personnalité de Gabriel Ringlet à travers Vous me coucherez nu sur la terre nue (Albin Michel, sept 2015)
Quatrième de couverture
 A l’approche de la mort, François d’Assise confiait à ses compagnons son souhait de reposer un moment « nu sur la terre nue ». C’est le sens de ce dévêtement ultime qu’explore ici Gabriel Ringlet, pour apporter un éclairage nouveau sur la fin de vie et son accompagnement.
A l’approche de la mort, François d’Assise confiait à ses compagnons son souhait de reposer un moment « nu sur la terre nue ». C’est le sens de ce dévêtement ultime qu’explore ici Gabriel Ringlet, pour apporter un éclairage nouveau sur la fin de vie et son accompagnement.
A partir de témoignages bouleversants, dont certains lui sont parvenus après le succès de son livre Ceci est ton corps, l’écrivain et théologien prend le parti de l’infinie douceur pour offrir un viatique qui trouve sens pour chacun.
Il témoigne également de son expérience dans un centre de soins palliatifs en Belgique -où la loi autorise pour certains cas l’euthanasie- et donne alors toute sa place à l’écoute et au rituel pour les personnes qui en font la demande. Les mots justes s’allient aux gestes simples pour cet adieu si singulier.
Une méditation sublime sur la nudité de l’absence, une célébration de la vie.
Extraits du chapitre La fée des hôpitaux
Caresser la souffrance de poésie est une pratique largement éprouvée qu’il ne faut surtout pas séparer du soin médical, psychologique ou spirituel. Eprouvée mais trop peu exercée à cause du regard erroné qui pèse encore sur elle. Comme si la poésie n’était que fantaisie, une manière d’échapper au monde, alors qu’elle en est un socle, un fondement. Permettez-moi de témoigner ici d’une chose toute simple : la poésie c’est ma vie, elle me tient debout et accompagne mes engagements. Je ne parle pas de faire des rimes, je parle du sang qui coule dans mes veines, de mon souffle, de mon haleine, de ma salive…Tous mes sens sont habités. Et du coup, que je visite un malade, que j’écrive un article, que je suive un match de football ou que je célèbre l’eucharistie…le poème est en moi. Mais en vous aussi ! Henri Meschonnic et Jean Sulivan l’ont suffisamment répété : « Nous sommes tous poètes. »
La poésie n’est pas quelque chose en plus dans votre vie, une option, un vernis, une culture, un au-dessus. Non ! Elle est un en–dedans. Et un en-dedans qui vient à mon secours, qui me soigne et peut me guérir, même si je vais mourir.
Quand je vois, au journal télévisé, des corps en lambeaux parce qu’une bombe a éclaté en plein marché, alors la poésie se soulève et se fait parole urgente pour affronter l’actualité et arracher le monde à son destin.
Une parole urgente que j’entends aussi dans le témoignage inouï de Jacques Lusseyran, résistant aveugle déporté au camp de Buchenwald entre janvier 1944 et mai 1945. Il raconte qu’en plein mois d’août et en plein camp, alors que les Alliés sont en train de libérer la France-mais il n’en sait rien-, assis sur un petit mur de pierre en face des lavabos, il se met à réciter des vers de Baudelaire et de Rimbaud. Peu à peu, il constate qu’une autre voix se mêle à la sienne, que les vers sont répétés dans l’ombre, que des hommes arrivent, puis d’autres encore qui font cercle autour de lui et prononcent les mots en écho, alors que presque aucun ne parle le français, pas même un peu. Ils savent qu’ils vont mourir bientôt et se jettent sur ces vers prononcés en langue étrangère comme sur du pain. Ce qui fait dire à Jacques Lusseyran devenu après la guerre professeur de littérature aux Etats-Unis, que la poésie est une médecine. Oui, une médecine au sens premier du mot, un soin qui modifie l’organisme humain.
Ce grand amoureux de la vie s’empresse d’ajouter que dans ce sinistre lieu, lui et ses codétenus ne récitent pas de la poésie « parce que c’est beau » mais « parce que ça fait du bien ». Alors, pour tenir le coup, celui qui osera parler de la joie jusque dans l’enfer de la violence quotidienne va organiser, en plein Buchenwald, une campagne de poésie. Car il veut élargir le cercle des bouleversés. Du coup, chaque jour, pendant quelques minutes, au milieu du bloc, il monte sur un banc à côté des lits et fait réciter à chacun, dans sa langue, les quelques vers qu’il connaît encore. Et tous, sans rien savoir de la langue de l’autre, se comprennent…
Extrait du chapitre Des « mains de menthe »
La souffrance a tellement besoin d’être caressée. Par des mains infirmières, certainement(…) Oui, bien sûr, un massage aux huiles essentielles demande du métier, un apprentissage, une dextérité, mais chacun ne peut-il pas devenir poète de ses mains ? Quand on sait comme un toucher délicat peut apaiser une tension nerveuse et calmer une anxiété, comment ne pas élargir et cultiver le jardin des caresses ? Je me dis que mes mains qui ont touché un tilleul ou un vieux pommier, qui ont été griffées par un rosier, caressées par un lilas ou une fleur de lin peuvent transmettre au souffrant le parfum de leur expérience jardinière. Travailler la terre d’un visage, la sarcler délicatement, la ratisser, la rafraîchir…n’est-ce pas donner une chance de lumière et de frisson à la végétation de ce corps étendu dans un lit ?
Extrait du chapitre Une femme m’a appelé
J’ai conscience d’aborder ici une question qui peut perturber, voire choquer. Je ne suis pas sûr qu’il y a cinq ou six ans, j’aurais rencontré le sujet dans le même état d’esprit qu’aujourd’hui. Sans doute parce que moi aussi j’ai cheminé. Et surtout parce qu’une femme m’a appelé(…)
Corinne van Oost m’a appelé deux fois. La première pour que j’accepte de cheminer, si je le pouvais, avec des personnes en grande interrogation spirituelle au cœur de leur demande d’euthanasie. Et la seconde, plus récemment, pour me proposer de réfléchir avec elle et avec son équipe à la question d’un rituel d’accompagnement de l’acte lui-même. Car(…) laisse-t-on l’acte à sa seule technicité, même attentive et délicate, ou conduit-on la démarche spirituelle jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à sa dimension rituelle ? Avec le recul et un début d’expérience, je découvre aujourd ‘hui cet appel comme une chance et une responsabilité, l’occasion rare de permettre à tousles acteurs de vivre, malgré et à travers la transgression, un moment d’exceptionnelle intensité.
Avant d’évoquer cette démarche qui en est encore à ses tout débuts, je souhaite redire une chose très simple que je répète de livre en livre, mais dont je pense qu’il faut l’affirmer avec plus de force encore encore aujourd’hui : célébrer touche aux fondements même de l’humanité. Célébrer, ce n’est pas fuir la vie ordinaire, c’est s’en emparer et la soulever pour lui offrir plus de légèreté. Et lorsqu’il s’agit de souffrance et de fin de vie en particulier, je me refuse à séparer trois mots qui se donnent la main : soigner, accompagner et célébrer. Soigner, évidemment, car il reste encore beaucoup à faire du côté médical dans la lutte contre la souffrance. Accompagner, élargir le soin jusqu’à sa dimension relationnelle. Et célébrer, c’est-à-dire élever, agrandir, élargir, porter plus loin ce qui se joue là de si exigeant et difficile. Car pour mettre au monde cette vie qui s’en va et prend un autre chemin, le patient, comme l’accompagnant et le soignant, a besoin de l’imaginaire, d’un récit, d’une musique, d’une photo, d’un poème, d’une prière…
Extrait du chapitre Grandir dans la transgression
En France, depuis mars 2015, la loi des députés Jean Leonetti et Alain Claeys reconnaît le droit à la sédation en phase terminale. Concrètement, le patient va pouvoir demander qu’on lui administre cette sédation qui l’entraînera à ne jamais se réveiller. Il s’en ira, inconscient, en quelques jours, voire en quelques heures. On se trouve là, de toute évidence, devant une euthanasie en quelque sorte diluée, une euthanasie déguisée qui préfère se cacher sous le mot « sédation », mais avec cette circonstance aggravante que le sens même de l’acte posé n’est ni honoré ni exposé à la parole. Or c’est pourtant là que réside la grandeur de l’humain, dans sa capacité à rendre compte de ses choix en se hissant gravement à la hauteur de l’enjeu. Et en osant une mise à jour explicite, un langage clair, indispensable pour qu’une équipe soignante, en son sein et dans son lien au patient et à son entourage, arrive à partager le sens d’une décision aussi importante. Il me semble que lors d’une euthanasie assumée en pleine lumière et vécue en équipe, où je reste à l’écoute du patient dans l’échange et la présence jusqu’au bout, je me sens et me trouve, finalement, bien plus en phase avec l’esprit des soins palliatifs.
Extrait du chapitre « Dis, parrain, qu’est-ce qu’elle va devenir ? »
Plusieurs fois par jour, avant de célébrer l’office liturgique, moines et moniales endossent la coule, un vêtement blanc à capuchon et longues manches qu’ils et elles passent au-dessus de leur tenue habituelle. Un peu comme si, pour chanter les psaumes et relire la Bible à longueur d’année, ce survêtement permettait d’entrer dans une autre durée. Voir moines et moniales s’affairer dans tous les coins de l’abbaye à cueillir, brasser, broder, cultiver, écrire, fabriquer du parfum ou du chocolat…et puis soudain, à l’appel de la cloche, en quelques minutes, les découvrir en coule à l’église, c’est un peu assister, en direct, au passage symbolique de l’ « ici-bas » à l’ « au-delà ».
J’ai toujours pensé qu’il ne fallait pas abuser du vêtement ecclésistique ou religieux. Ni confondre les plans. L’habit ne fait pas le moine, ni le prêtre. Par contre, il en va autrement du vêtement liturgique qui indique, lui, le passage à une autre dimension. Cela ne veut pas dire que le profane, les joies et les soucis du monde n’ont pas de place dans la liturgie. Ni que le profane, dans sa profanité quotidienne, ne peut être sacré. Il ne faut pas nécessairement changer de lieu et de vêtement pour passer d’un monde à l’autre. Toutefois, le recul de la célébration aide à mieux empoigner le profane pour le rendre sacré. Revêtir la coule permet ainsi au moine et à la moniale, mais au prêtre aussi, en aube et en étole, de saisir ce profane à pleines mains et de lui faire franchir une frontière. C’est un vêtement baptismal en quelque sorte. Entrer dans la coule et en sortir, c’est comme plonger dans le Jourdain et se relever. Le silence, le chant, la musique, la poésie du texte biblique, mais aussi la coule, contribuent beaucoup à cette traversée.
La coule que le moine ou la moniale reçoit le jour de sa profession solennelle, et qui marque son identité monastique, va aussi l’habiller une dernière fois le jour de sa mort car, en principe, le corps est déposé à même la terre, sans cercueil, dans sa coule. « C’est étonnant, me confie Bénédicte, une trappistine, nos enterrements ressemblent aux enterrements des torahs trop usées à force d’être lues…Peut-être, en revêtant la coule, mettons-nous le cap sur un ailleurs, entraînant dans notre sillage l’humanité avec laquelle nous sommes embarqués. »