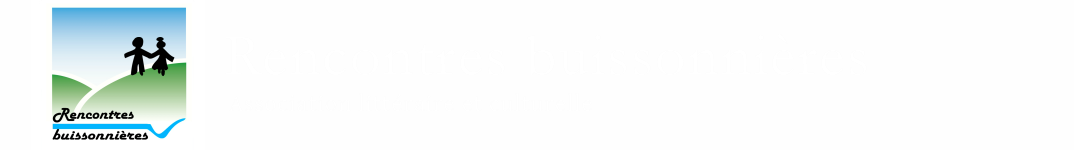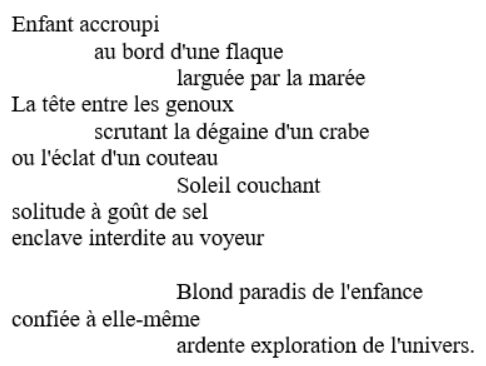Je vous écris du désastre, je vous écris de Pâques.
Si j’ai entrepris de célébrer le quotidien qui me tient tellement à cœur, je ne puis pour autant négliger l’événement-rupture du quotidien par définition-qui a déclenché l’écriture mais aussi un chemin personnel à travers la vie, une méthode littéralement:la mort brutale, à trois mois d’écart, de mon père et de ma mère, qui nous laissait orphelins.
Ce jour-là
Nous étions heureux tous les cinq et nous le savions. Sans doute la guerre, l’exode et la captivité de mon père en Allemagne avaient-ils favorisé la prise de conscience du simple bonheur d’être ensemble. Nous cinq, c’est-à-dire lui, qui aimait son métier et les siens, elle qui incarnait à ses yeux la beauté, la joie de vivre, mon frère de quatre ans, ma sœur de deux ans et moi. Oui, en cette juste après-guerre nous étions des gens heureux, donc sans histoire. L’enfance dansait au soleil.
Un matin d’octobre 46, tout a basculé. J’avais sept ans, l’âge que l’on dit de raison. Mon père rentrait d’une visite dans la campagne quand un tram a heurté sa voiture, le tuant net. Ce midi-là, en rentrant de l’école, mon frère et moi, nous n’avons plus reconnu la maison envahie de parents, d’amis qui entouraient Maman en larmes, méconnaissable. A suivi une période étrange pendant laquelle Maman, malade et désespérément triste-une autre Maman, pas celle que nous connaissions «avant»(puisque désormais il y avait un avant et un après)-se traînait, recevant péniblement des inconnus susceptibles de racheter la clientèle de notre père. Jusqu’à ce qu’en décembre, à bout de forces, elle accepte l’hospitalité de sa sœur aînée et nous entraîne loin de la maison, de l’école, de la rue, de la ville. Début janvier 47, Maman terrassée mourait à son tour et nous, les enfants, nous étions répartis entre les familles fraternelles. A nouveau plus rien ne ressemblait à rien. Ni les visages, ni la maison, ni la rue, ni l’école. Rien.
Lorsque je me retourne vers ce temps déjà lointain, je mesure à quel point ce 17 octobre a modifié ma trajectoire: j’ai appris d’un coup combien la mort est imminente, surprenante. J’ai compris une fois pour toutes que n’importe qui(même ce papa fort, rieur, invincible) pouvait mourir n’importe quand. L’angoisse qui a escorté cette découverte a pris des formes diverses, au nombre desquelles je compte la peur des voyages en voiture, la claustrophobie. Par contre, elle a communiqué à la vie, celle d’ici et de maintenant, une saveur sans pareille. Chaque matin, je m’étonne et je me réjouis d’être en vie ; je ne m’y habitue pas. J’ai appris aussi combien on pouvait compter sur l’amour des proches: ceux-là qui nous ont élevés comme leurs propres enfants avec une tendresse sans calcul. Ils nous ont prouvé que rien n’est jamais fini et que l’amour est vraiment plus fort que la mort.
La poésie est ma langue maternelle. Pour dire l’essentiel, je recours à ce langage elliptique et imagé qui fait appel non à la raison raisonnante mais à l’émotion et à la sève des mots, à ce qui bouge en chacun sous la couche de la routine, la cuirasse de la prudence. Comment exprimer autrement l’expérience initiale qui m’a bouleversée ?
Secrète présence
Singulières et plurielles
De l’aube elle garde un air de royauté. Si démunie soit-elle, elle porte trace d’anciennes richesses. Comme une cape l’immuniserait du mal, du gel. On l’aperçoit égarée dans une rue, une gare, un bureau ; on la voit pareille à toutes les femmes. Une fine poussière recouvre déjà son visage qui fut vif, brillant et malicieux ; un retard dans les gestes, la démarche, l’achemine, loin du fracas et de la fureur, vers la blessure toujours fraîche des tombes. De l’enfance elle détient un talisman.