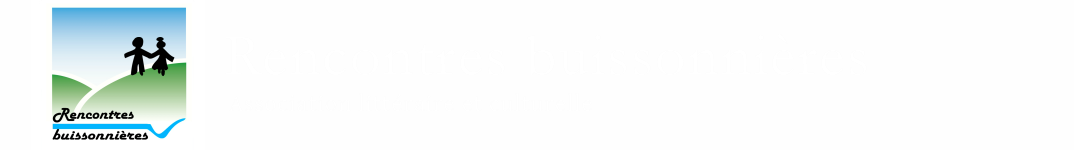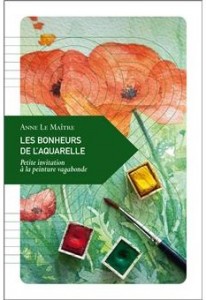Petite invitation à la peinture vagabonde
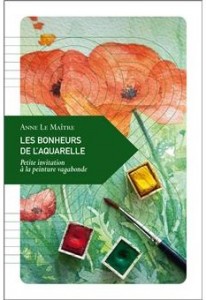 Pour moi comme pour tous ceux qui ne partent jamais en randonnée ou en voyage sans avoir glissé au préalable dans leur bagage un bloc de papier, un crayon et quelques tubes de couleur, la peinture vagabonde – cette façon d’aller à la rencontre du réel un pinceau à la main – est plus qu’une activité : un mode de vie.
Pour moi comme pour tous ceux qui ne partent jamais en randonnée ou en voyage sans avoir glissé au préalable dans leur bagage un bloc de papier, un crayon et quelques tubes de couleur, la peinture vagabonde – cette façon d’aller à la rencontre du réel un pinceau à la main – est plus qu’une activité : un mode de vie.
Le chemin, c’est ce qui transporte à travers le temps aussi bien qu’à travers l’espace-temps long de l’histoire ou temps béni de l’enfance, quand septembre avait le goût des poires mûries au soleil. Et ceci, surtout : le chemin, c’est la maison. On y marche, bien sûr. Mais on y mange aussi. On s’y assoupit pour une sieste heureuse à l’ombre d’un pin. Enfant, on y a fait ses devoirs en surveillant du coin de l’oeil la flaque d’eau la plus proche et sa population de têtards. Les années passent. Devenue adulte, un jour, on se souvient du poids du cahier sur les genoux, de la blancheur aveuglante du papier quand le soleil y danse. Alors on attrape un carnet, un crayon et comme un enfant, on apprend. On apprend les rondeurs d’une colline et la couleur des feuilles ; on apprend l’ombre du lézard et la course du vent. On a troqué le stylo contre un pinceau chargé d’eau et de bleu avec lequel on tente de saisir dans un même trait la légèreté du ciel et celle de l’enfance. On pourrait aussi bien se trouver à la table de la cuisine, achevant un devoir sous la lampe, ou à son bureau, mettant la dernière touche à un travail tandis que la pluie bat les vitres. On lève la tête, on observe pour la centième fois en dix minutes la façon dont ce saule se penche sur la mare et on se dit que rien n’a changé : le chemin, c’est la maison.
Partir avec un carnet de croquis, c’est s’en remettre aux choses pour déterminer le rythme même de sa progression, la durée des arrêts et la fréquence des pauses. Une chapelle ou un chardon, un petit âne à l’abreuvoir, un cornouiller chargé de fruits : tout peut décider du moment où il va ralentir, poser son sac et sortir un bout de papier. La durée même de sa pause méridienne finira par dépendre de la prestesse avec laquelle il capturera la rondeur écarlate d’une pomme avant de croquer dedans- et s’il y ajoute le plaisir d’une sieste, ce sera encore parce que le temps suspendu du dessin l’aura invité à l’abandon. Se dépouiller un peu plus. S’ouvrir. Il lui faudra garder le cœur disponible s’il veut être capable d’entendre l’appel de ce qui l’entoure. Et sa façon de voyager changera.
 Seul le temps de la marche me semblait offrir une chance de moissonner les merveilles que recèlent ces quelques dizaines de kilomètres. J’ai dessiné, donc, et moissonné(…) Je me suis fait une foulure et des amis…
Seul le temps de la marche me semblait offrir une chance de moissonner les merveilles que recèlent ces quelques dizaines de kilomètres. J’ai dessiné, donc, et moissonné(…) Je me suis fait une foulure et des amis…
A chaque fois que mon pas se pressait, il y avait quelque chose-un moineau, une rivière ou une abbaye classée au patrimoine mondial de l’humanité- pour me retenir, me ralentir et me dire : regarde, sens, écoute. Dessine. J’ai bien consacré dix minutes à croquer un pissenlit en contrebas de Taizé – combien de temps lui avait-il fallu pour pousser ? Alors qu’il ne m’aurait pas fallu une seconde pour prendre une photo.
L’instantané photographique, apte à tout capter du monde en un centième de seconde, ne remplacera jamais le temps long du dessin qui dans ses traits emprisonne, en même temps que ce jardin explosant de rosiers, les trente minutes passées à le dessiner, un peu du mois de juin, une fraction de l’histoire du monde, une demi-heure de la vie baignée dans le parfum des roses. De la même façon, j’écris d’abord ce livre à la main, en longs sillages d’encre sur la page blanche. Ce qui impose à ma pensée un rythme particulier (au clavier jécrirais plus vite) et me permet de la mieux saisir dans son ensemble : à gauche de mon bureau s’empilent les feuillets déjà rédigés, matérialisant de façon instructive et satisfaisante l’avancée de mon travail. Et puis, pourquoi le nier, il y a aussi le plaisir sensuel de l’écriture ; je choisis toujours avec gourmandise ces gros feutres noirs qui glissent si bien sur la feuille blanche. Parfois, je continue d’écrire sans plus rien avoir à dire, pour le pur plaisir de la sensation.
Assieds-toi.
Regarde.
Attends.
Surtout, prenons le temps que les choses adviennent : il en advient tellement.
J’étais absorbée dans un délicat mélange d’ocre et de vermillon quand deux enfants survinrent, perchés sur des vélos trop grands pour eux, qui s’enquirent gravement de ce que je faisais sur ce banc, de si j’étais perdue, et pourquoi mon sac avait l’air si lourd. Nous discutâmes chèvrefeuille, dessin et marche à pied dix bonnes minutes avant que le garçonnet – je me souviens qu’il s’appelait Maxime- ne conclue que tout ceci était étrange mais que chacun faisait bien à sa guise, et ne tire de sa poche un gâteau sec un peu poussiéreux qu’il me tendit avec un sourire anxieux. A son grand soulagement, je déclinai l’offre : c’était là son quatre-heures, voyez-vous, et il n’avait que deux biscuits.
Le dessin fut raté mais qu’importe ? Il y avait pour moi, ce jour-là sur la route, un petit garçon de 6 ans prêt à partager son goûter.
 La première fois que j’ai touché aux petits godets colorés d’une boîte d’aquarelle, il y a fort longtemps, le jour où, le cœur battant, j’ai ouvert sur ma table un manuel du style « J’apprends l’aquarelle en dix leçons », je me suis lancée dans la réalisation d’une marine. Quinze centimètres de ciel, trois autres centimètres pour la mer et entre les deux, pour donner l’échelle, le triangle rouge d’une voile. Suivant minutieusement les instructions du livre, j’ai humecté ma feuille sur toute sa surface, préalable indispensable à la réalisation d’un lavis. Puis, avec la pointe un peu tremblante d’un pinceau, j’ai déposé quelques touches d’indigo à l’angle gauche, un mélange de brun de garance et de sienne brûlée en dessous, pour finir tout en bas par deux bandes de bleu de Prusse…Et j’ai vu naître sous mes yeux un ciel chargé d’orage, un soleil que voilaient les nuages et des flots gonflés de colère. C’était miraculeux. Par le jeu de l’eau libre et des pigments, tout un paysage naissait sous mes yeux, tout un monde dont j’étais le démiurge, le dieu créateur, capable d’un trait sombre de précipiter la chute des anges ou, grâce à une gouttelette d’eau tombée de mon petit doigt, d’ajouter à l’horizon la promesse d’une éclaircie.
La première fois que j’ai touché aux petits godets colorés d’une boîte d’aquarelle, il y a fort longtemps, le jour où, le cœur battant, j’ai ouvert sur ma table un manuel du style « J’apprends l’aquarelle en dix leçons », je me suis lancée dans la réalisation d’une marine. Quinze centimètres de ciel, trois autres centimètres pour la mer et entre les deux, pour donner l’échelle, le triangle rouge d’une voile. Suivant minutieusement les instructions du livre, j’ai humecté ma feuille sur toute sa surface, préalable indispensable à la réalisation d’un lavis. Puis, avec la pointe un peu tremblante d’un pinceau, j’ai déposé quelques touches d’indigo à l’angle gauche, un mélange de brun de garance et de sienne brûlée en dessous, pour finir tout en bas par deux bandes de bleu de Prusse…Et j’ai vu naître sous mes yeux un ciel chargé d’orage, un soleil que voilaient les nuages et des flots gonflés de colère. C’était miraculeux. Par le jeu de l’eau libre et des pigments, tout un paysage naissait sous mes yeux, tout un monde dont j’étais le démiurge, le dieu créateur, capable d’un trait sombre de précipiter la chute des anges ou, grâce à une gouttelette d’eau tombée de mon petit doigt, d’ajouter à l’horizon la promesse d’une éclaircie.
Savourer la porte entrebâillée, l’osmose d’un instant établie entre le reste du monde et moi. Sur ma feuille ouverte comme une paume, un peu du réel vient se poser. Chut ! Le bruit même d’une pensée l’effaroucherait, et c’en serait fini de la rencontre.
J’ai toujours été frappée par le fait qu’il y a dans l’aquarelle quelque chose qui s’approche de l’expérience du zen. Une façon concentrée de faire silence, de se laisser emplir par les choses, de délaisser le sentiment au profit de la sensation. Ce n’est plus moi qui regarde la fleur, c’est la fleur qui pousse en moi ses feuilles et ses pétales(…) Des carmels aux chartreuses, des temples tibétains aux ashrams indiens, toutes les grandes spiritualités invitent à rejoindre cet état de vacance de l’âme dans le silence de laquelle la présence divine a une chance de se révéler. Ou le nirvana, c’est selon.
Le dessin, pour humble ou maladroit qu’il soit parfois, nous redonne ce que la photographie a trop souvent fait oublier : l’affirmation de l’existence d’un regard. Il n’est que d’aller rôder au rayon « carnets de voyage » d’une librairie pour découvrir trente-six Afrique, dix-huit Italie et quinze routes de la soie dont chacune n’appartient qu’à celui ou celle qui l’a parcourue. Je ne suis pas le monde, dit le dessin, j’en suis une vision.
S’il est un art, le carnet de voyage est l’art de l’humilité.
Le voyage, de toute façon, rend humble. Vous quittez vos habitudes, votre tribu, votre territoire. Vous vous perdez faute de cartes ou parce que vous êtes incapable de déchiffrer l’alphabet dans lequel sont rédigés les panneaux(…)Vous devenez le meilleur ami des chiens errants, des enfants et des simples d’esprit. Rien de mieux qu’un crayon et une feuille quand les autres ne vous comprennent pas. J’ai le souvenir d’un après-midi passé à dessiner tous les animaux de la jungle pour une petite fille norvégienne qui rêvait d’être un tigre(…) Tandis qu’elle m’apportait l’une après l’autre toutes les figurines en plastique de sa caisse de jouets pour que j’en fasse le portrait, nous avons eu ce long échange au-dessus de la feuille, ponctué de murmures appréciateurs et d’éclats de rire. Les mots ne sont pas toujours nécessaires. Quand un aviateur perdu au milieu du désert dessine « une caisse avec trois trous d’aération », il se trouve toujours un Petit Prince pour voir le mouton qui dort à l’intérieur.
 Le silence rend possible bien des rencontres(…) Un midi, je m’étais arrêtée dans un bois au-dessus de Mâcon. Je venais de découvrir sur une souche un merveilleux insecte noir et bleu ciel : un Acanthocinus oedilis, la Joconde des insectes, un défi lancé à mon sens de l’observation. Je ne faisais pas un bruit, mis à part peut-être quelques crissements du crayon sur le papier. J’ai été dérangée par un craquement incongru. A 5 mètres de moi dans la clairière, un jeune chevreuil déjeunait de feuilles de châtaignier. Il ne m’avait pas vue, ou, s’il l’avait fait, il avait considéré que ma personne ne valait pas une course éperdue dans les fourrés par 30°C à l’ombre. Il est resté là un moment, mâchonnant d’un air amical. Pour un peu, il serait venu regarder par-dessus mon épaule et m’aurait donné son avis : les chevreuils sont des bêtes très curieuses. Comme avec celle du gros homme d’Aumont-Aubrac, comme celle du petit Maxime sur son vélo ou celle du pissenlit au bord du chemin, nos vies se sont croisées dans cette clairière, durant une dizaine de minutes. Là-bas, du côté de la Saône, je sais une forêt qui abrite un chevreuil avec lequel j’ai tissé des liens personnels ; elle n’en est que plus belle.
Le silence rend possible bien des rencontres(…) Un midi, je m’étais arrêtée dans un bois au-dessus de Mâcon. Je venais de découvrir sur une souche un merveilleux insecte noir et bleu ciel : un Acanthocinus oedilis, la Joconde des insectes, un défi lancé à mon sens de l’observation. Je ne faisais pas un bruit, mis à part peut-être quelques crissements du crayon sur le papier. J’ai été dérangée par un craquement incongru. A 5 mètres de moi dans la clairière, un jeune chevreuil déjeunait de feuilles de châtaignier. Il ne m’avait pas vue, ou, s’il l’avait fait, il avait considéré que ma personne ne valait pas une course éperdue dans les fourrés par 30°C à l’ombre. Il est resté là un moment, mâchonnant d’un air amical. Pour un peu, il serait venu regarder par-dessus mon épaule et m’aurait donné son avis : les chevreuils sont des bêtes très curieuses. Comme avec celle du gros homme d’Aumont-Aubrac, comme celle du petit Maxime sur son vélo ou celle du pissenlit au bord du chemin, nos vies se sont croisées dans cette clairière, durant une dizaine de minutes. Là-bas, du côté de la Saône, je sais une forêt qui abrite un chevreuil avec lequel j’ai tissé des liens personnels ; elle n’en est que plus belle.
Alors être soi-même, véritablement soi-même, uniquement et humblement soi-même, serait-ce la recette du dessin et du voyage réussis ? Qui sait ?
L’artisanat du trait opposé à l’industrie photographique atteste qu’ici du moins, du temps a été pris, un hommage a été rendu. On frôlerait le sacré, alors- de celui qui passe son temps à quelque chose ne dit-on pas qu’il s’y consacre ? Manière de réconfort pour ceux qui, n’ayant pas la possiblilité, la chance ou le cran de s’en aller tout simplement contempler le monde, se trouvent apaisés de savoir que d’aucuns ont pris cette peine(…)
Et voici qu’un nouveau personnage entre en scène.
Le lecteur.
Spectateur à son tour, empruntant les lunettes d’un autre, contemplateur de la contemplation d’autrui, ce voyageur au carré, tout immobile qu’il est, maraude dans les vergers du voleur de pommes. Qui est-il ? Qu’en sera-t-il de cette nouvelle histoire engagée entre l’auteur et lui(avec le voyage comme prétexte), entre le paysage et lui(avec l’auteur comme entremetteur) ? S’il est vrai que le bonheur de la peinture vagabonde est de permettre la rencontre, en voici bien une autre. C’est comme un jeu d’échos multiples. Le lecteur, c’est celui qui prend le temps de l’écoute, de la contemplation. C’est celui qui s’assied au bord de la page comme un autre s’est naguère posé au bord de la route. Qui s’oublie pour une heure et lui laisse la parole. Dans cette épreuve olympique qu’est la course de relais, le bâton que se transmettent les coureurs est appelé le témoin. Encore une merveille de la langue française : à croire que ce simple bout de bois est là pour garder trace de l’effort des précédents, de leur sueur, de leur concentration. Le carnet sera peut-être ce témoin que l’on passe à d’autres, à charge pour eux, s’ils le souhaitent, de continuer le voyage(…)
Et si jamais la rencontre se produit avec un lecteur ? Cela viendra comme un cadeau de plus, qui parfera le voyage. Une bénédiction supplémentaire sur la route, aussi belle, aussi simple que la rencontre d’un aquarelliste et d’un pissenlit.
Mes dessins ne seront rien de plus que cette herbe au bord du chemin.